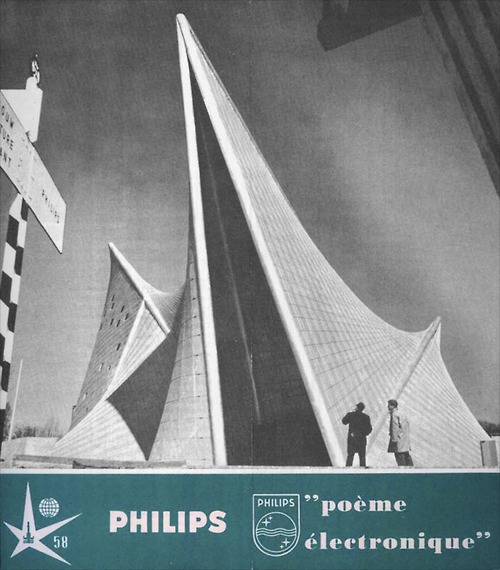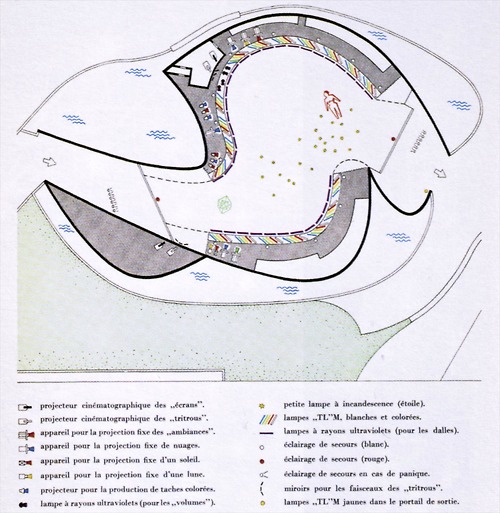Via Le Monde, via Philippe Rahm Architectes
-----
Par Philippe Rahm
A quelques semaines des élections municipales, il n'a jamais fait aussi beau à Paris. Le soleil brille, il fait chaud et pourtant on nous déconseille de sortir dehors à cause de la pollution de l'air qui atteint des sommets. Mauvaise nouvelle pourdéjeuner en terrasse. C'est assez paradoxal, ce beau temps qui ne l'est en réalité pas. Cela ne va pas de soi et il nous faudra réviser à l'avenir nos critère du beau et du laid, ne plus se fier au perceptible, au soleil, à la température et au ciel bleu, mais plutôt à l'invisible et se dire le matin qu'il fait beau seulement quand le bulletin météo annoncera pour la journée un taux bas de particules fines dans l'air.

Le nuage de pollution à Paris, jeudi 13 mars. | AP/Christophe Ena
Mais si le bulletin météo classique nous informait de l'état du ciel selon des forces naturelles qui nous dépassaient et contre lequel on ne pouvait choisir que de prendre ou pas son parapluie, le problème de la pollution des villes est une conséquence des activités humaines. Et parce qu'il nous concerne tous, parce qu'il définit la réalité chimique de nos rues et de nos places, parce qu'il menace notre santé, il est éminemment politique. J'affirmerai même qu'il est la raison d'être fondamentale du politique: celle de nous assurer à tous une bonne santé. Le politique est né de la gestion sanitaire de la ville et de la définition de ses valeurs publics que l'on retrouve inscrit aujourd'hui dans les règlements et les plans d'urbanisme: avoir de la lumière naturelle dans toutes les chambres, boire de l'eau potable, évacuer et traiter les déchets et les excréments. En-dessous de son interprétation culturelle, l'Histoire de l'urbanisme et du politique est finalement celle d'une conquête physiologique, pour les villes, pour les hommes, du bien-être, du confort, de la bonne santé.
Et respirer un air sain en ville ? Ne pourrait-on pas penser que c'est finalement cela que l'on demande aujourd'hui au politique ? La demande n'est pas neuve. Au début du XIXe siècle, Rambuteau, préfet de Paris, avait tracé la rue du même nom au coeur du Marais pour faire circuler l'air pour éviter le confinement des germes. Dans sa suite, le préfet Haussmann traçait les boulevards dans un même soucis d'hygiène, y plantait des arbres pour les tempérer, créaient des parcs (les Buttes-Chaumont, le bois de Boulogne, etc.) comme Olmsted avec Central Park à New-York, conçues à la manière de poumons verts pour rafraîchir la ville en été, absorber les poussières et la pollution, améliorer la qualité de l'air, parce qu'à l'époque, on mourrait réellement de tuberculoses et des autres maladies bactériennes dans les villes.
Mais toutes ces mesures sanitaires ont perdu leur légitimité avec la découverte de la pénicilline et la diffusion des antibiotique à partir les années 1950. À quoi cela servait-il encore de raser les petites rues sans air et obscures du Moyen-Âge, de déplacer les habitations dans de vastes parcs de verdure si l'on pouvait chasser la maladie simplement avec un antibiotique à avaler deux fois par jour durant une semaine. Etait-ce vraiment raisonnable d'élargir les petites fenêtres des vieilles maisons en pierre, d'enlever les toits en pentes pour en faire des toits terrasses, si en réalité, on pouvait éviter la maladie avec un peu de pénicilline ?
Si l'on a arrêté de démolir les vieux quartiers des villes européennes à partir des années 1970, si on a commencé à trouver du charme aux ruelles tortueuses et aux vieilles maisons étroites du Moyen-Âge, aux intérieurs sombres et humides des centres villes, si les prix des arrondissements historiques que tout le monde désertait jusqu'aux années 1970 ont commencé à grimper, si des mesures de protections du patrimoine ont été votées, si ces vielles pierres sont devenues des témoins de notre civilisation et un atout touristique et économique, si l'on est revenu habiter les vieux centres historiques, on le doit peut-être autant aux théories post-modernes de Bernard Huet, l'architecte des la place Stalingrad et des Champs-Elysées dans les années 1980, qu'à la découverte médicale des antibiotiques.
Mais les antibiotiques ne peuvent rien contre la pollution aux particules fines d'aujourd'hui. Cela veut-il dire que nous allons assister au même phénomène que durant la première partie du XXe siècle, celle d'une désertion des centre-villes, d'une perte de valeur immobilière des quartiers centraux de Paris, au profit des banlieues et des campagnes où l'air n'est pas polluée ? La ville que l'on a réappris à aimer et à habiter à la fin du XXe siècle va t-elle retombée dans la désolation ? On peut tenter de croire, dans un monde globalisé, que la mission de la politique locale est aujourd'hui de réduire le chômage ou de diminuer les impôts. Mais plus profondément, le politique se doit aujourd'hui de reprendre en main sa mission fondamentale, celle d'assurer la qualité de nos biens publics, celle de nous offrir en ville, après l'eau et la lumière, un air de qualité, seule garantie pour la prospérité sociale et économique future.
Philippe Rahm construit en ce moment un parc de 70 hectares pour la ville de Taichung à Taiwan, livré en décembre 2015 qui propose d'atténuer la chaleur, l'humidité et la pollution de l'air par l'emploi du végétal et de technologies vertes.
Philippe Rahm (Architecte et enseignant aux Universités de Princeton et Harvard (Etats-Unis))